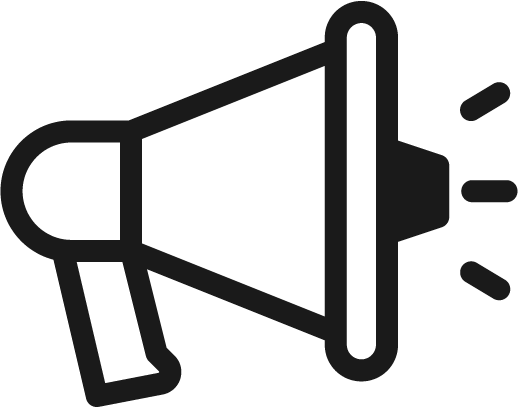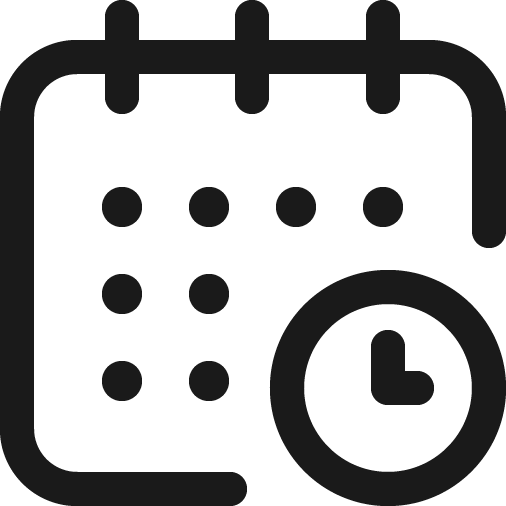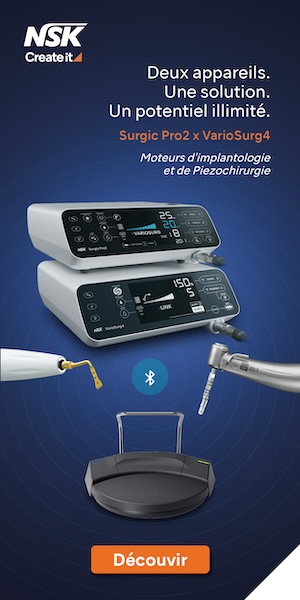La protection sociale en Europe et en France
Juridique - Droit Par Jean Vilanova le 04-07-2016En matière de protection sociale, l’Europe se définit par deux systèmes. L’un est qualifié de « bismarckien », l’autre de « beveridgien » et chaque pays se réfère à l’un ou à l’autre de ces systèmes, voire emprunte aux deux comme c’est le cas pour la France.
Le système bismarckien
Fondé par le chancelier Otto von Bismarck à la fin du XIXème siècle, ce système est en cours en Allemagne et dans les pays d’Europe centrale. La protection sociale repose sur une base assurantielle obligatoire à partir d’un financement assuré par des cotisations versées par les salariés et leurs employeurs. Les cotisations en question ne sont pas proportionnelles au risque qui pèse sur la personne mais à son niveau de salaire. La gestion du système se fait paritairement (salariés et employeurs).
Le système beveridgien
Inspiré par Lord William Beveridge, un économiste britannique du milieu du XXème siècle, le système beveridgien s’applique en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves notamment. Système assistanciel, gratuit et financé par l’impôt, sa gestion relève uniquement de l’Etat (principe d’unicité). La protection sociale se veut universelle – toute la population en bénéficie – et uniforme quant aux prestations versées qui sont donc fondées sur les besoins de la personne et non sur la perte de ses revenus.
Et la France ?
Notre pays emprunte aux deux systèmes même si « la marque » bismarckienne s’avère plus profonde. Pour preuve la reprise dans le système français de la logique de redistribution, de la protection obligatoire, du niveau de cotisation proportionnel au salaire, du financement et de la gestion paritaire. La protection sociale française n’en emprunte pas moins au système beveridgien son universalisme mais elle le fait par ses propres voies. Non pas de façon automatique par la citoyenneté comme c’est le cas en Grande-Bretagne mais par le statut ; d’abord la personne qui cotise (le salarié, l’employeur) puis, par strates successives, la généralisation à l’ensemble des populations non cotisantes (ayants droit, étudiants, personnes sans ressources suffisantes…) Globalement, l’objectif beveridgien d’universalisme est atteint dans notre pays même si le cheminement pour y parvenir nécessite l’adoption de solutions adaptées au contexte économique du moment et différentes selon les populations visées.
De ce point de vue, il s’agit donc d’un universalisme de fait davantage que de principe ce qui n’en diminue en rien ni la force, ni la générosité.